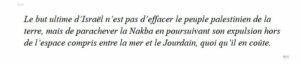
Cinq grandes questions pour mieux comprendre l’action et les discours portés par ces collectifs en lutte
1/ Contre qui et quoi se battent ces collectifs ?
Ces conflits d’aménagement apparemment locaux semblent cohérents au niveau national au moins au vu des stratégies institutionnelles ou privées auxquelles les habitant·es font face.
2/ Qui sont les acteurs de ces mobilisations ?
Comment ces mobilisations parviennent-elles à rassembler des acteurs aussi hétérogènes – riverain·es indigné·es, jeunes militant·es du mouvement climat, paysan·es, etc ?
3/ Pourquoi ces habitant·es se mobilisent-ils/elles ?
Quelles sont les motivations de leur engagement qui reviennent, et lesquelles mettent ils/elles en avant ?
4/ Comment luttent ces collectifs ?
Quelles méthodes sont privilégiées, quel type d’action ? Ces collectifs sont-ils plutôt légalistes, politiques, zadistes ?
5/ Les collectifs en lutte constituent-ils un “mouvement social qui s’ignore”, une entité cohérente ? Se coordonnent-ils, mobilisent-ils un récit et des actions communes ?
Contre quoi ces luttes se mobilisent-elles ?
Quels projets contestés
La cartographie réalisée par Reporterre nous indique l’ampleur géographique du phénomène : toutes les régions françaises y compris ultramarines sont concernées par des conflits d’aménagement. Ces projets sont multiples : infrastructures de transport, entrepôts commerciaux, installations classées etc. L’échantillon questionné montre le refus par les collectifs d’un capitalisme orienté vers la consommation de masse (32% des projets) et la destruction des espaces dits « naturels ».
Quels sont les acteurs visés ?
En grandes catégories de porteurs de projets, l’Etat, les collectivités ou les promoteurs privés sont essentiellement mis en cause par les collectifs.
Les conflits se jouent particulièrement contre les collectivités territoriales, en tant qu’aménageurs directs, meneurs d’enquêtes publique, référents locaux du pouvoir politique. Les collectivités territoriales continuent souvent à porter ces projets car elles sont prises désormais dans une logique de concurrence des territoires, avec une incitation financière à l’urbanisation, des arguments d’autorité sur l’attractivité, …
L’Etat dans ses diverses déclinaisons tient également une place importante d’accompagnement des projets – même s’il est peu cité comme un adversaire direct. Il l’est surtout dans les luttes plus anciennes avec une vision plus globale.
Les entreprises privées restent les premières bénéficiaires des projets. Elles gardent le plus souvent une relative discrétion, voire un silence total, particulièrement lorsqu’elles ne sont pas du territoire. Mais elles agissent, par exemple par un travail de lobby auprès des élu·es et de contre-information affirmé, par la publicité dans la presse locale.
Stratégies des porteurs de projets et freins à l’action
- Un cas récurrent est celui de la stratégie du « fait accompli » lorsque les travaux démarrent sans que les autorisations soient délivrées ou les procédures respectées.
- L’opacité de l’information est aussi relevée très majoritairement dans nos entretiens comme l’une des stratégies les plus handicapantes. Complexité volontaire des documents noyés dans une masse, infos « oubliées » ou non versées au débat public, calculs biaisés, usage exclusif d’internet pendant le confinement sont autant de techniques vues et revues pour camoufler un projet.
- Certains aménageurs investissent également énormément d’argent et de temps dans les procédures judiciaires, conduisant parfois à l’épuisement des riverain·es mobilisé·es.
Les collectifs font aussi face à des stratégies de disqualification et exercice de la violence (il)légitime
- D’abord via des discours de disqualification qu’une petite moitié des répondant·es évoquent. Accusation d’être des « empêcheur·ses de tourner en rond », toujours « opposé·es », ou stigmates déjà connus : celui de l’écologiste « bobo », de classes moyenne, extérieur·e au territoire, du ZADiste. Les collectifs y répondent par un redoublement d’effort quant au travail d’information ou par l’affirmation de leur statut de riverain·e concerné·e
- La peur de s’impliquer dans une polémique locale ou celle d’associations locales de perdre leurs subventions sont évoquées comme freins récurrents;
- Et de la répression directe dans une dizaine de cas : administrative (interdictions de manifester ou de circuler), policière (ZADs essentiellement mais pas seulement), ou même avec des organisations miliciennes.
D’où viennent ces collectifs en lutte ?
Les personnes mobilisées contre ces projets inutiles et imposés sont avant tout des citoyen·nes, des habitant·es, des riverain·es. C’est ainsi qu’ils et elles se décrivent lorsqu’on les interroge. En étant souvent directement concerné·es, ils et elles voient menacés mettent en jeu leurs santés, leurs vies, leurs patrimoines, leurs environnements directs et en retour engagent d’autant plus d’énergie dans leur action.
Contrairement aux discours de disqualification sur l’appartenance « bobo » des personnes mobilisées, cette proximité directe, cet attachement et le fait d’être directement concerné·es par les conséquences économiques ou environnementales des projets contestés, incitent régulièrement à l’entrée en engagement de catégories populaires dans les collectifs et associations. S’ils ne sont pas majoritaires, on notera ainsi un grand nombre d’agriculteurs et agricultrices, ou leurs familles
Néanmoins on observe très souvent une « difficulté » à mobiliser ses voisin·es évoquée, à nuancer étant donné l’ampleur de certaines mobilisations et la participation régulière de classes populaires. Sur 47 réponses, 12 évoquent des mobilisations à plus de 500 personnes (souvent une réussite en milieu rural) et 21 entre 100 et 500.
Pourquoi ces habitant-es se mobilisent-ils/elles ?
Les arguments de fond avancés
L’enquête montre trois causes principales de conflits qu’on retrouve quel que soit le type de projet contesté :
- L’artificialisation d’espaces naturels ou agricoles (73% des cas étudiés)
- Les effets pour les habitant·es : quasiment tous les enquêté·es dénoncent les effets sur les habitations et écoles à proximité du projet (pollution, nuisances, …);
- Des préoccupations écologistes générales. Climat, biodiversité, écosystèmes : ces enjeux font largement partie des motivations données par les enquêté·es, démontrant leur sentiment d’appartenance à un combat global. Elles sont pourtant rarement mises en avant, les collectifs leur préférant des questions touchant plus directement les riverain·es, pour convaincre.
-
Dans un contexte de mouvement pour le climat fort qui semble avant tout citadin, « la question climat » en tant que telle n’est évoquée que dans une dizaine d’entretiens.
-
L’attachement patrimonial, ainsi que les risques pour la santé, font aussi partie des points importants, mobilisant des catégories sociales différentes.
Le déni de démocratie locale comme déclencheur
Mais l’élément le plus fondamental tient au sentiment d’un déni de démocratie face à l’implantation d’un projet démesuré. Si celui-ci n’a pas été repéré comme central dans les argumentaires publics, le caractère « imposé », voire mensonger et souvent disproportionné des projets explique la spontanéité des mobilisations étudiées. Les termes « corruption », « mensonge », « secret » sont ainsi parmi les vocables les plus réguliers que nous avons recueillis. La découverte par hasard ou recherche complexe d’un lanceur d’alerte indigne et crée souvent l’étincelle initiale.
Les demandes concrètes
La radicalité de l’opposition aux projets est à souligner.
- Devant les projets que nous avons décrits, les mobilisations étudiées demandent de façon nettement majoritaire leur abandon total (69%, fig. 11). Viennent ensuite des critiques formulées quant au lieu de son implantation (10%), ou d’une partie du projet (12%) lorsque par exemple celui-ci intègre une raison légitimant sa conduite mais également un projet jugé inutile.
Comment les collectifs s’organisent-ils ?
Les stratégies d’action
Les collectifs s’appuient en général sur 6 modes d’actions pour lutter contre les grands projets inutiles imposés:
La publicisation de la lutte : dans respectivement 75% et 83% des réponses, les réseaux sociaux et les médias sont ainsi considérés comme « cruciaux » et « importants », très peu de collectifs faisant l’impasse sur cette tâche. L’accès aux médias locaux n’est pourtant pas toujours évident, et les collectifs les plus avancés contournent ça via des médias nationaux et/ou alternatifs, ou par les réseaux sociaux.
L’interpellation des élu·es constitue aussi une pratique quasi systématique (89% des cas). C’est est également l’une des plus critiquées car elle est souvent considérée comme inutile (31% des cas), à l’instar des pétitions (45% des cas).
La sensibilisation des riverain·es, par une présence physique et continue dans tous les espaces disponibles. Tractage dans les marchés, affichages dans l’espace public (64% les considèrent comme cruciaux ou importants), etc. Les répondant·es au questionnaire évoquent également l’expertise comme « cruciale » dans 26% des cas et comme « important et régulier » dans 36%.
Le recours juridique, s’il n’est pas le mode d’action le plus récurrent (utilisé dans 77% des cas, derrière les médias, les outils d’informations, marches ou pétitions par exemple) est le mode d’action considéré comme le plus « crucial » par les collectifs et associations étudiées (43%, devant les médias – 38%) et comme « important et régulier » pour 21% des répondant·es (total = 64%). Considéré comme efficace, il apparaît néanmoins comme usant et très coûteux par les collectifs.
- La désobéissance civile : Les collectifs et associations ont globalement conscience de l’insuffisance des moyens d’action juridiques et politiques cités. La désobéissance civile, parfois aux frontières ou outrepassant pacifiquement la loi, est devenue un mode d’action privilégié du mouvement écologiste sous l’impulsion de certaines organisations.
ZAD ou pas ZAD ? Globalement peu de cas mais quasi tous y songent. Certain·es collectifs sont pourtant initialement très respectueux·ses de la loi mais annoncent que « si la justice ne fonctionne pas, on est prêts à faire une ZAD même si on a aucune idée de comment faire.” C’est plus par pragmatisme stratégique que par idéologie que les collectifs renoncent à mettre en œuvre ce mode d’action.
Les projets « alternatifs » ou « contre-projets ». Malgré l’investissement que ces actions demandent, notons qu’une courte majorité (51%, fig. 12) des répondant·es au questionnaire les ont mis en œuvre et même s’il ne s’agit que d’une action « cruciale » que pour 15% des répondant·es. Pour autant ce moyen d’action nécessite du temps, une expertise et des ressources souvent trop importantes pour ces collectifs en l’état.
Un mouvement social et global qui s’ignore ?
En 2018, le collectif scientifique « Des Plumes Dans le Goudron » observait que « [ces mouvements d’opposition contre les GPII] ont connu ces dix dernières années un changement d’ampleur comme de nature, et constituent aujourd’hui un mouvement social décentralisé, en cours d’organisation ». Ce constat renouvelé rappelle que l’ancrage territorial des collectifs et associations n’est en aucun cas un frein à la politisation du conflit
Plus en profondeur, c’est également la connaissance du territoire et de ses problématiques par ses habitant·es qui permet de contraster avec des projets polluants et exploitant les ressources environnementales locales. A l’instar du « localisme », la démocratie locale, son usage et sa défense, viennent donc être des moteurs d’une cause commune qui se forge et se développe, du territoire vers une échelle plus large. A partir de cet ancrage du discours au local, les collectifs et associations développent également une pensée économique et sociale – ou à partir d’argument économique, en creux d’un enjeu environnemental et écologique où la connaissance du territoire, mieux que l’adversaire, est essentielle lorsqu’il s’agit de critiquer le retour de l’emploi industriel jugé illusoire et sans avenir.
Une conscience globale mais pas nationale ?
C’est à la fois un sentiment d’appartenance global et une intermédiation militante (Extinction Rebellion, Partager C’est Sympa…) qui viennent forger cette appartenance globale plutôt que la « question climat » en elle-même. Les collectifs eux-mêmes, conscients d’appartenir à des dynamiques plus grandes qu’eux, ont également conscience d’être les intermédiaires de l’écologie politique lorsqu’on leur pose la question. Si les causes locales peuvent être nationalisées lors de grands rassemblements ou de campagnes médiatiques, il n’émerge (pour l’instant) pas de cause en soi nationale au sein de cet espace de mobilisation et à partir des luttes locales elles-mêmes.
La très grande majorité des collectifs évoquent spontanément lors des entretiens l’existence de liens territoriaux avec d’autres collectifs en lutte. Des alliances fortes existent avec des syndicats et les Gilets Jaunes ont également été cités comme des alliés de la mobilisation dans 4 cas. Au-delà de ces cas « spontanés », cette mise en réseau tient également au travail actif mené par des organisations nationales. La « victoire » contre l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes largement citée n’a pas produit d’effet de réplique massive du mode d’action « ZAD » mais participe à un imaginaire structurant.
C’est donc la maturité de l’organisation interne de ce mouvement social et la convergence profonde de ses discours que nous retiendrons ici.
Des événements, contextes ou des organisations nationales qui permettent le développement d’un mouvement social au-delà de la somme des luttes.
La quasi-totalité des collectifs et associations citent a minima une association ou ONG nationale. Cette omniprésence permet donc la circulation d’expériences, de savoirs militants et un soutien financier non négligeable pour les actions juridiques. Dans les cas des réseaux contre Amazon et les extensions d’aéroports, le financement de salarié·es chargé·es de campagne permet également de tisser des liens parfois descendants (formation, appui juridique), ascendants (plaidoyers communs) ou horizontaux (par l’organisation de réunions inter-collectifs régulières).
Ces formules variées de coordination viennent donc affirmer l’existence d’un mouvement social qui, s’il n’est pas unifié (et s’il n’a pas nécessairement à l’être) autour du label « GPII » ou dans un même espace formel, produit en son sein des organes d’auto-développement, démontrant ainsi sa capacité à vivre comme une entité qui dépasse la somme des combats locaux.
Conclusion
Nous observons ainsi un mouvement social qui s’ignore de moins en moins, proposant un contre-discours cohérent, écologiste, démocratique, social et économique face à un capitalisme prédateur qui ne cesse de s’étendre. Ce mouvement social décentralisé dispose d’atouts majeurs en l’espèce de son inventivité, de ses réseaux, de sa pluralité stratégique et sociologique, de la profondeur de son discours. Des atouts qui lui permettent d’engranger de plus en plus de victoires : la cartographie de Reporterre comptabilise 37 victoires totales ou partielles rien que ces 2 dernières années. Et qui nous donnent autant de raisons d’espérer et de travailler collectivement à le renforcer !
terresdeluttes.fr
