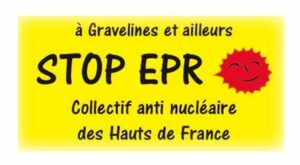Terreur et stratégie de l’impuissance
La suspension des activités de Médecins sans frontières (MSF) dans deux centres de santé et l’assassinat, le 31 mars 2025, de deux sœurs religieuses sont autant de marqueurs de la descente aux enfers d’Haïti. L’Église a réagi en dénonçant l’inaction du pouvoir, dont l’impuissance renvoie à l’histoire du pays et à l’ingérence internationale.
Le Centre tricontinental est un centre d’étude, de publication et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud, les enjeux de la mondialisation et les mouvements sociaux en Afrique, Asie et Amérique latine
Le 31 mars dernier, un nouveau massacre a eu lieu en Haïti. Parmi les victimes figurent Evanette Onezaire et Jeanne Voltaire, deux sœurs catholiques. Une semaine plus tard, à la suite d’une attaque ciblée survenue le 15 mars contre un convoi de MSF, l’organisation a annoncé suspendre ses activités dans deux structures. Ce double événement consacre à la fois l’extension territoriale des gangs au sein et en-dehors de la capitale Port-au-Prince, contrôlée à 85% par les bandes armées, et l’étendue de leur emprise, à laquelle plus aucun espace ni symbole – social, culturel ou religieux – n’échappe.
Ces quatre dernières années, MSF a dû, à plusieurs reprises, suspendre ses activités et déplacer ses centres en fonction des attaques et de l’avancée des gangs. En avril 2021, des hommes lourdement armés étaient entrés, en plein office, dans une église adventiste pour kidnapper quatre personnes. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. Une dizaine de jours plus tard, c’est un groupe de sept religieux catholiques, dont deux Français, qui étaient enlevés. Dénonçant la « dictature du kidnapping » par laquelle les gangs s’enrichissent, l’Église catholique avait appelé alors, phénomène inédit, à la grève des écoles, universités et hôpitaux dans son giron afin de protester contre l’insécurité.
Depuis lors, les religieux n’échappent pas à la violence. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’église Sacré-Cœur de Turgeau, dans le cœur de la capitale (et où se situait l’un des centres de MSF qui a suspendu ses activités), a été attaquée. À l’instar des autres institutions – publiques, médiatiques (les locaux de trois médias ont été saccagés le mois dernier), culturelles (c’est aujourd’hui la fondation emblématique FOKAL qui risque à tout moment de tomber entre les mains des gangs) –, les églises sont devenues des cibles. Elles n’offrent plus aucun refuge à une population cernée de toutes parts et abandonnée par l’État, qui ne cesse de résister.
Descente aux enfers
De 2021 à aujourd’hui, la même image revient – celle d’une « descente aux enfers » –, la même prière et la même dénonciation de l’inaction des autorités. Ainsi, dans son dernier communiqué, la Conférence haïtienne des religieux a exprimé « sa profonde douleur, mais aussi sa colère devant la situation infrahumaine », critiquant les « soi-disant leaders de ce pays, [qui] tout en s’accrochant au pouvoir, sont de plus en plus impuissants ».
De 2021 à 2025, de l’assassinat du président Jovenel Moïse au Conseil présidentiel de transition actuel, en passant par les deux ans et demi du gouvernement catastrophique d’Ariel Henry, soutenu à bout de bras par la communauté internationale, l’effondrement du pays s’est aggravé et accéléré. Plus d’un million de personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont déplacés par la violence et la moitié de la population a besoin d’une aide humanitaire.
Les autorités haïtiennes se succèdent, la violence s’accroit, l’impunité se renforce. L’embargo sur les armes – dont la quasi-totalité provient des Etats-Unis – et le régime de sanctions décidés par l’ONU sont peu ou pas appliqués, tandis que les quelques mille policiers de la mission multinationale armée, sur place depuis des mois, paraissent peu actifs et, de toute façon, inefficaces. L’échéance électorale de cet automne est un mirage auquel, par lâcheté ou intérêt, seules la classe politique haïtienne et la communauté internationale s’accrochent, pour ne pas reconnaître la faillite de la stratégie poursuivie jusqu’à présent. La transition est bloquée et il n’y aura pas d’élections.
À la merci des forces destructrices
À juste titre, l’église dénonce tout à la fois les exactions des gangs armés et l’inaction, sinon la complicité du pouvoir. Mais la passivité et l’indifférence de la classe politique en Haïti sont le pendant de l’interventionnisme de Washington et d’une oligarchie tournant le dos à la population pour mieux répondre aux injonctions internationales. Quelle puissance publique, quelle volonté politique peuvent en effet se déployer dans un pays piégé dans une équation internationale saturée par la dépendance et l’ingérence ?
La matrice néocoloniale s’est cristallisée en 1825 avec l’imposition par la France à son ancienne colonie d’une indemnité de 150 millions de francs pour dédommager les planteurs qui avaient perdus, avec leurs terres et leurs esclaves, toutes leurs richesses. À défaut de pouvoir recoloniser Haïti, on s’assurait de son contrôle. En échange, l’État français « concédait » une indépendance acquise vingt-et-un ans plus tôt, en 1804, à la suite du soulèvement des esclaves et d’une révolution qui avait chassé les troupes napoléoniennes.
Cette rançon contribua à enfermer le pays dans une spirale d’endettement, de crises et d’interventions étrangères. Elle consolida dans le même temps l’élite haïtienne et la logique impériale. Au fil du temps, Washington se substitua à Paris et la dépendance changea de direction. Demeure l’exigence des Haïtiens et Haïtiennes d’obtenir réparation de la France et de se dégager de l’emprise états-unienne.
« L’absence de réaction efficace face à l’insécurité persistante est un échec grave qui met en péril la nation abandonnée à la merci des forces destructrices » affirme la Conférence haïtienne des religieux. Les manifestations contre l’insécurité et la passivité des autorités en place se multiplient ; manifestations lourdement réprimées par la police. Le Réseau national de défense des droits humains (Rnddh) dénonce un « terrorisme d’État, qui, depuis 2018, est établi comme mode de gouvernance » et l’absence de plan des autorités, qui « cantonne l’institution policière dans un rôle de sapeurs-pompiers ». L’impuissance du gouvernement, la terreur des gangs, l’ingérence internationale ne sont pas des fatalités, mais des manières de gouverner dont les Haïtiens et Haïtiennes veulent se libérer.
CETRI