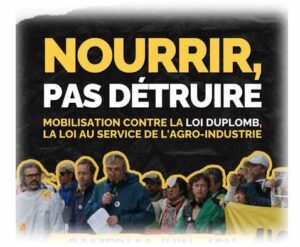
Et prendre les gens pour des cons
« Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. » Raoul Vanegeim, La vie s’écoule, 1974.
Des membres de Ruptures étaient présents à la mobilisation de STopMicro de mars 2025, « De l’eau, des terres, pas des puces ». Pendant, et à la suite de cette mobilisation d’ampleur, notre collectif a été animé de nombreux débats concernant la capacité à mobiliser, à agir et à s’organiser politiquement sans trahir les principes qui nous animent. Cette Nouvelle Vague propose une réflexion sur les formes d’organisation que nous souhaitons chérir et voir émerger pour qu’adviennent enfin de véritables bouleversements sociaux
Lutter contre son temps
On ne niera pas que la situation actuelle est pour le moins alarmante : montée des régimes autoritaires, des extrêmes droites, des populismes, des politiques liberticides, déferlement technologique, remilitarisation, tensions géopolitiques, et en toile de fond, des ravages environnementaux qui ne cessent de s’accroître. L’époque semble au désenchantement et on se sent si impuissants face à l’ampleur de la merde dans laquelle on baigne. La tentation de la résignation, de la dépression, du nihilisme ou du repli mystique en guette plus d’un – à quoi bon agir politiquement puisque rien ne change et tout empire ? La politique institutionnelle n’est que désillusions et dégoûts en cascade, fouler ou jeter le pavé semble de plus en plus dérisoire face aux 49.3 du gouvernement, le syndicalisme n’est plus la proposition de rupture radicale avec le système qu’il fut et la vague de soulèvements mondiaux de l’année 2019-2020 (France, Hong-Kong, Chili, Algérie, Iran, Bolivie, Irak…) qui avait suscité tant d’espoirs semble loin derrière nous.
Face à la gravité d’un état du monde qui semble se détériorer toujours davantage, nombreux sont les militants et les groupes politiques à être animés par le sentiment de l’urgence à agir. Ce sentiment les conduit bien souvent à adopter une vision court-termiste de recherche d’efficacité dans l’action politique : nous n’aurions plus le temps de discuter, d’argumenter pour convaincre, de réfléchir, de nous attarder sur l’horizontalité, l’éthique ou nosprincipes. Il nous faudrait aujourd’hui agir vite et guidés par un souci premier d’efficacité, de résultat et de puissance.
On voit ainsi apparaître un nombre croissant de groupes qui, au nom d’un objectif « révolutionnaire » et de la quête d’efficacité, en viennent à revendiquer une certaine verticalité et adoptent des pratiques et des réflexes, souvent inconsciemment, issus du management et de la culture néolibérale : logique du rendement et du retour sur investissement dans l’engagement politique, culture du chiffre pour mesurer ses objectifs, vision court-termiste, spécialisation et hiérarchie dans l’organisation, management de soi et mise sous pression des militants (conduisant parfois à des burn-out, comme dans le salariat), marketing pour « glamouriser » les luttes, attirer et susciter l’engagement, instrumentalisation des personnes perçues comme des unités s’additionnant pour grossir une manifestation ou un collectif et manque de considération à l’égard des individus, etc. Nous pensons qu’il est en réalité « contre-productif » d’ériger l’efficacité en principe premier : cette logique inhibe la créativité, la spontanéité et l’enthousiasme en brimant tous les en-dehors, toutes les actions dont les effets ne seraient pas directement mesurables. Elle devient rapidement pressurisante et ne prend pas en compte les limites et les singularité des individus. Elle ne permet pas e temps nécessaire pour la prise de recul, la remise en question et le doute. Elle crée de la fatigue, démobilise et coupe les élans. De plus, dès lors que l’on fait primer l’efficacité et l’urgence, cela se fait toujours au détriment de l’éthique. On en vient à juger que tous les moyens sont bons, du moment qu’ils permettent d’arriver aux fins : il devient acceptable de recourir à des formes de manipulation, de dissimuler les intentions et les objectifs, d’accepter une dose toujours plus importante de verticalité et de discipline, de mentir sur les effets que l’on produit au motif que le discours porté sur les actes a plus de poids que les actes eux-mêmes, etc.
Or, nous pensons que ce qui fait partie de la « catastrophe », ce ne sont pas juste les limites planétaires qui sont dépassées une à une, la casse sociale et la menace de guerre mondiale, c’est aussi la manière dont les liens humains et les manières de s’organiser politiquement sont affectés par cet esprit du temps. Nous croyons que changer le monde, c’est aussi changer la vie quotidienne, et nous ne pensons pas que cela sera possible en adoptant l’idéologie et les outils écrasants du système capitaliste et technicien. Comment parvenir à des rapports sociaux radicalement différents de ceux que nous impose le capitalisme si pour cela on utilise les mêmes méthodes (culte de l’efficacité et de la productivité par exemple) ?
Et combattre avec les gens
On nous demandera alors sans doute ce que nous proposons, quelles formes d’actions politiques nous défendons. Pour tenter de répondre à ces questions, un petit détour par ce qui a motivé la création du collectif Ruptures s’impose. Octobre 2021. Dans sa « guerre au virus », le gouvernement a mis en place un « pass sanitaire », ce qui nous inquiète et révolte. On rejoint les manifs hebdomadaires où on diffuse la Nouvelle Vague. À ce moment-là, la majorité des militants de gauche les ont désertées. Elles seraient trop mal fréquentées (présence de groupes d’extrême droite et/ou conspirationnistes). C’est en parti vrai, bien que très réducteur. Mais alors, pourquoi notre collectif, plutôt libertaire et franchement anti-capitaliste, rejoint une manif parfois confuse et éloignée de nos orientations politiques ?
Pour commencer, nous partons du postulat que nous sommes tous, bien qu’à des degrés divers, englobés, incorporés, dans la société que nous contestons. On y est né, elle nous traverse bien autant que d’autres. Par conséquent, de quel droit porterions-nous un regard surplombant ou condescendant sur les autres manifestants sans les avoir écoutés auparavant ? Si nous avons confiance en nos convictions, cela n’exclut pas, au contraire, de l’ouverture et une part de doute. En tous les cas, il nous semble pertinent de développer une critique sur les grandes structures et les idéologies qui orientent cette société (technologie comme solution à tout, marchandisation de l’existence, contrôle et destruction du vivant…), plutôt que sur les individus qui la composent. Évidemment, cela n’exclut nullement une remise en cause de certains comportements individuels. Concrètement il s’agit de considérer qu’en chaque humain, quel qu’il soit, il y a un commun rejoignable. Que ce commun demande à être compris et défendu, et ce sont ces bases que nous voulons prôner comme fondement de notre engagement politique.
Par ailleurs, nous pensons qu’il faut partir de la situation présente, de ce que vivent une majorité de gens, plutôt que de plaquer sur la réalité nos désirs d’une autre société. On ne discute pas avec des idéaux sur pattes, mais avec des gens de chair et de sang. Ne parler qu’à des gens avec qui on est d’accord, cultiver un entre-soi rassurant, n’est-ce pas
le meilleur moyen de passer à côté de ce qu’ont à dire les autres ? Il est nécessaire de porter nos idées et de les confronter hors de nos cercles habituels (squats, lieux « alternatifs », brochures, bouquins, etc.), dans des lieux où elles sont habituellement
invisibles (marchés, lieux publics, etc.). Provoquer du débat, de la réflexion ou de l’énervement vis-à-vis d’une société qui nous mène à l’abîme et nous abîme est certes un travail qui peut être fatiguant, c’est pourtant essentiel. Se confronter à l’altérité, y compris à travers des discours qui peuvent nous irriter, nous enrichit. Cela nous oblige à sortir de notre idéalisme, à écouter d’autres façons de penser, à nous questionner sur nos arguments, à les affiner, voire à les modifier. Ce type d’échange ne peut se faire que sur une base de sincérité et de curiosité. Et cette base ne peut exister si nous nous pensons comme une élite de la pensée, venue porter la bonne parole à des gens qui n’auraient rien compris.
Il ne s’agit pas d’être naïf, de proclamer que tout le monde détient un bout de vérité et de tomber dans un relativisme qui ne peut que miner, fausser et tire vers le bas toute réflexion. Ce dont il s’agit, c’est plutôt de faire un pari optimiste : faire confiance
à l’intelligence collective, à la possibilité d’élever ensemble le débat, à la capacité de quiconque à se forger une opinion sur des faits, à recevoir des arguments, et à en échanger d’autres. Bref, à créer des moments où l’on développe l’esprit critique et
où on renforce notre compréhension du monde, collectivement et individuellement. C’est un pari osé au vu de la vigueur avec laquelle nombre d’« élites » politico-médiatiques rabaissent au niveau du caniveau toute forme de réflexion et d’analyse
critique sur notre société. Il faut s’enlever de l’esprit que « la politique c’est les autres », qu’il n’y a rien à faire, sauf à déléguer dans une urne, un parti, ou à appeler le défenseur des droits. La chose politique commence par la prise de conscience qu’en tant
qu’humains nous avons des valeurs et des conditions d’existence à défendre, et que celles-ci sont communes à un grand nombre de personnes. Ce pari repose sur la croyance en l’humain. À ce stade, de vieux mots largement galvaudés et obsolètes nous
viennent à l’esprit : humanisme, universalisme…
Ces principes ne sont pas un décorum pour rendre plus jolies nos soifs de changement, elles en sont le cœur. Les cultiver et les entretenir au travers de nos rapports quotidiens à autrui est central pour nourrir le reste car l’arbre est dans la graine : nos actes et nos
actions d’aujourd’hui déterminent ce qui se passe ou pourrait se passer demain, il ne faut pas l’oublier. Il s’agit d’être conséquent, cohérent avec ce que nous prônons politiquement au niveau collectif. Au niveau individuel, respecter nos principes et notre
éthique donne du sens et de la dignité à nos vies. Chaque fois que nous pensons qu’il y a quelque chose qui cloche, qu’il ne devrait pas en être ainsi, que notre sens moral est bafoué, que nos dignités sont malmenées ou qu’il y a une injustice en face de nous, c’est une prise pour commencer à se coaliser et à agir sur le réel. Ces deux échelles, collectives et individuelles, ne devraient jamais s’exclure, mais au contraire s’auto-alimenter. On ne peut pas vouloir à la fois un avenir égalitaire et solidaire, et se comporter comme une raclure pour essayer de l’obtenir.
Pas de programme mais des envies à partager
On ne croit plus guère aux fadaises du type « le Grand Soir », à la Révolution magique qui réglera tout, une bonne fois pour toutes. Non pas qu’une rupture majeure avec le cours actuel de l’histoire ne soit souhaitable. Pour tout dire, on l’espère fortement, cette rupture.
Mais le bouleversement que constitue un moment historique révolutionnaire n’est qu’une prémisse : les choses se construisent ensuite, sur la durée, le temps long, en tâtonnant, en faisant parfois des erreurs, voire en acceptant qu’on ne trouvera pas de solutions à tout par le politique. Le doute n’est pas signe de faiblesse, plutôt d’intelligence, de sensibilité et d’ouverture.
On n’a pas de programme clé en main à proposer, car cela ne peut se faire que dans l’action et avec d’autres. Par contre on a envie de cultiver l’humilité au lieu du fantasme de la « puissance », la sincérité plutôt que la manipulation, le partage plutôt que l’entre-soi, la considération plutôt que l’instrumentalisation, l’indépendance de jugement plutôt que les dogmes. Cela ne fait pas tout, mais c’est, nous semble-t-il, le préalable à toute action politique ambitionnant de remettre au centre du jeu l’humain et le reste du vivant.
Ruptures, le 20 juin 2025
Article publié dans La nouvelle vague n°20, juin 2025 ; collectif Ruptures
