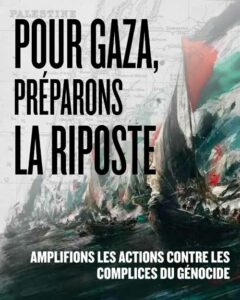
un degré de fusion entre religion et politique encore jamais atteint
Dimanche 21 septembre, les funérailles de l’influenceur d’extrême droite, en présence de Donald Trump, ont donné lieu à des scènes au potentiel “explosif”, analyse Philippe Gonzalez, spécialiste du protestantisme évangélique aux États-Unis.
Une cérémonie de plus de cinq heures, une foule de quelque cent mille personnes réunie dans un stade XXL… Pouvait-on s’attendre à un tel dispositif, pour rendre hommage à un simple influenceur ?
Un « simple influenceur » qui n’en était pas moins une figure de proue de la droite ultraconservatrice au sein de la jeunesse américaine, et que sa mort a transformé en véritable martyr, pour ses fans. D’où les accents bibliques de cette cérémonie d’hommage reprenant tous les canons des grands événements évangéliques… sauf que les pasteurs y étaient paradoxalement absents, en tout cas bien moins nombreux que des membres du gouvernement ou du parlement reprenant tout naturellement leur rhétorique chrétienne en y infusant leurs idées politiques. On pouvait s’y attendre peut-être, mais ce degré de fusion entre le religieux et le politique n’avait encore jamais été atteint, depuis qu’il a pris racine, durant les années 1980, à partir de la campagne du Républicain Ronald Reagan pour la présidentielle…
Une bascule ?
J’en suis encore sous le coup. Cela fait vingt ans que je travaille sur ces questions, et ce scénario d’intrication que j’envisageais comme une éventualité extrême, lors de mes premiers travaux de recherche sur le terrain évangélique américain, est devenu réel. Le voir s’incarner sur scène est très impressionnant. D’autant que tous ces politiciens ne se contentent pas d’instrumentaliser la rhétorique religieuse à des fins politiques, comme du temps de Reagan. Je ne sais jusqu’où va leur cynisme, mais la plupart sont d’abord profondément convaincus que Dieu les appelle pour sauver les États-Unis de leur ennemi intérieur… Lequel, à leurs yeux, peut aussi bien prendre le visage des immigrés que des trans, des féministes que des militants d’extrême gauche. Ce sont ces politiques-là qui aujourd’hui se retrouvent sur le devant de la scène, en roue libre, avec un potentiel explosif qui fait froid dans le dos.
Parce qu’ils font de cette rhétorique religieuse une rhétorique guerrière ?
Lorsque Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint de Donald Trump et fondateur de l’America First Legal Foundation [AFL : une organisation conservatrice intervenant en soutien juridique des décisions présidentielles contestées], évoque comme il l’a fait au cours de la cérémonie une « lutte implacable » contre ces forces du mal, il faut y voir un véritable appel à la vendetta, à la guerre civile que des pasteurs évangéliques « prophétisent » du reste depuis des années. Le président américain lui-même, qui s’imagine à l’avant-garde d’un « combat civilisationnel », a tenu un discours de haine assumée et revendiquée, évoquant son intention d’« écraser » tous ses ennemis.
Plus que l’idéologie, n’est-ce pas la paranoïa qui unit le mouvement Maga (« Make America great again », le slogan du président américain) ?
Un grand historien américain, Richard Hofstadter (1916-1970), fut le premier à le pointer, en publiant Le Style paranoïaque. Théories du complot et droite radicale en Amérique. Pour autant on ne peut parler de « folie douce » ou de simples élucubrations, car les mesures de rétorsion prises par le mouvement Maga arrivé au pouvoir sont bien réelles, elles. On le voit avec la liberté d’expression, si chère au président américain, mais qui ne vaut que pour lui, puisqu’il a fait suspendre coup sur coup les émissions de deux humoristes connus, Stephen Colbert et Jimmy Kimmel [ce dernier étant finalement réintégré]. Sans parler des listes qui ont été dressées de personnes n’ayant pas mis la main sur le cœur au moment de l’hommage à Charlie Kirk : elles sont aujourd’hui menacées de mort sociale, que ce soit par leur licenciement ou le retrait de leur permis de conduire ! En fait, les États-Unis ressemblent de plus en plus à la Hongrie de Viktor Orbán, qui est devenue à la fois leur modèle et leur laboratoire.
Comment un tout petit pays tel que celui-ci pourrait-il donner le la à la plus grande puissance mondiale ?
Un tout petit pays situé au cœur de l’Europe, qui fait figure de poche de résistance héroïque, d’avant-poste ou d’avant-garde, et qui est donc devenu aujourd’hui le laboratoire de l’ultradroite américaine. Ses mesures antimigratoires, son contrôle des médias, sa politique nataliste, son illibéralisme, etc., l’inspirent au point que des pépinières de jeunes Républicains américains vont y séjourner pour en rapporter « la bonne parole »… que la religion chrétienne comme ciment identitaire viendra conforter tout à fait.
Télérama
