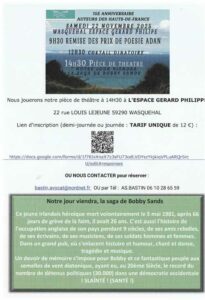
« La stigmatisation des pauvres accroît le sentiment d’anxiété et d’insécurité économique »
Dans une tribune au « Monde », le juriste décrit les mécanismes d’une véritable « guerre contre les pauvres plutôt que contre la pauvreté », menée par un Etat-providence qui contrôle plus qu’il ne protège.
** **
https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/10/22/olivier-de-schutter-rapport
L’économiste juif hongrois Karl Polanyi, alors exilé aux Etats-Unis, détaillait en 1944 dans La Grande Transformation, les raisons de la montée de l’extrême droite en Europe. Il soulignait que la foi sans limites des élites dans l’autorégulation du marché et l’absence de mécanismes de sécurité sociale au moment de la crise économique de 1929 ont plongé une grande partie de la population dans une extrême pauvreté, favorisant la désignation de boucs émissaires et la montée des fascismes. Tirerons-nous les leçons de son enseignement ?
Les parallèles avec la situation actuelle sont trop nombreux pour pouvoir être ignorés. Depuis les années 1980, l’affaiblissement progressif du système social hérité de la période d’après-guerre plonge de plus en plus de personnes dans un état d’insécurité économique. Dans un contexte de crise de la croissance keynésienne et de hausse du chômage, les fondements mêmes de notre système social ont été graduellement remis en cause par les thèses néolibérales.
L’approche d’une protection sociale universelle, fondée sur l’existence de droits sociaux garantis par la Constitution, a été remplacée par une approche conditionnelle. Les dépenses de sécurité sociale sont désormais considérées comme un coût à réduire plutôt que comme un investissement nécessaire au maintien de la cohésion sociale et à la lutte contre la pauvreté.
Dérive dystopique
En réalité, on a assisté à un grand retournement de la politique sociale : du rôle protecteur qui était le sien, l’Etat-providence est passé à un rôle de contrôle. Les dispositifs qui le constituent expriment une méfiance envers des pauvres jugés coûteux, peu méritants, voire fainéants. Les politiques dites « d’activation » conditionnent désormais l’obtention d’une prestation sociale à une période d’activité, dans le but affiché « d’inciter » les personnes en situation de pauvreté à travailler, suggérant qu’elles sont tentées par l’oisiveté.
C’est ce que traduit la récente réforme du revenu de solidarité active (RSA), dont le versement est désormais conditionné à quinze heures d’activité gratuites par semaine. Dans une récente communication au gouvernement français, j’ai mis en garde contre les impacts de cette mesure qui, comme le soulignent la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pourrait mener à une augmentation du taux de non-recours aux prestations ainsi qu’à des cas relevant de la qualification de travail forcé. A ce jour, le gouvernement français n’a pas répondu à nos inquiétudes à ce sujet.
Lire aussi la tribune : RSA : « Conditionnalité et automaticité sont deux objectifs contradictoires »
La dématérialisation de l’accès à l’aide sociale est une autre illustration de cette dérive aux accents dystopiques. Le « tout-numérique » peut aggraver le phénomène de non-recours aux aides sociales et fragiliser les conditions de vie de nombreuses personnes en situation de pauvreté. En outre, les outils algorithmiques permettent d’automatiser contrôles et sanctions.
La Caisse d’allocations familiales (CAF) a, par exemple, ciblé de manière discriminatoire des familles monoparentales ainsi que des personnes en situation de handicap. Cela mène à des retraits rétroactifs de prestations, aggravant ainsi la situation des bénéficiaires. Non seulement ces formes de contrôle constituent un frein au recours aux aides sociales et à la sortie de la pauvreté, mais elles sont souvent vécues par celles et ceux qui les subissent comme une humiliation.
Territoires abandonnés
L’extrême droite prospère sur l’essor des inégalités et la peur du déclassement au sein des classes moyennes et populaires. Dans un contexte économique morose marqué par la stagnation des salaires et de nombreuses délocalisations, la stigmatisation des pauvres accroît encore davantage le sentiment d’anxiété et d’insécurité économique des classes moyennes paupérisées. Elle risque ainsi de renforcer les divisions sociales en opposant les « pauvres » aux « encore plus pauvres », d’une part, et « nos pauvres », jugés dignes d’être aidés, aux « migrants » qui viendraient leur faire concurrence, d’autre part. Ces dynamiques alimentent le discours décliniste des populistes d’extrême droite, qui attribuent l’insécurité économique à des boucs émissaires désignés par leurs origines ethniques.
Lire aussi (2021) | Pourquoi les pauvres votent-ils à droite ?
Pour inverser la tendance, les politiques sociales doivent être refondées sur le principe d’universalité de la protection sociale, qui constitue un droit humain. Ces efforts doivent se doubler d’un plan de cohésion territoriale, permettant de garantir une véritable égalité d’opportunités entre populations des zones rurales et habitants des villes, alors qu’aujourd’hui beaucoup de ruraux ont le sentiment de vivre dans des territoires abandonnés, méprisés par les élites urbaines.
La montée des populismes d’extrême droite est le résultat direct de la refonte néolibérale du modèle social d’après-guerre. Pour enrayer leur progression, la guerre contre les pauvres doit être remplacée par une guerre contre la pauvreté.
Olivier De Schutter est rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme.
