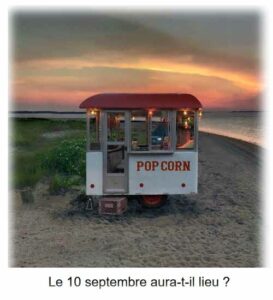
Les sanibroyeurs de l’écologie
L’histoire du magazine Le sauvage
La trahison du prolétariat par la gauche est connue (La deuxième droite , Garnier et Janover, 1986. Sisyphe est fatigué , Serge Halimi, 1993). Celle des écologistes beaucoup moins. Elle était enfouie dans la grande fosse d’aisance de la gauche. L’en extirper nous prémunira peut-être contre les faux espoirs, le ressentiment, l’impuissance.
Par leur culture libertaire, leur refus de la société industrielle et son gouvernement technocratique, les écologistes se mettent immédiatement en porte-à-faux avec les politiques traditionnelles. La gauche, plutôt que d’entretenir un conflit électoralement désastreux, opère un aggiornamento tactique. En 1972, le célèbre rapport du Club de Rome sur les Limites de la croissance lui offre de traduire la révolte de la jeunesse dans son langage gestionnaire. Claude Perdriel, riche industriel de toilettes chimiques et patron du Nouvel observateur , fonde avec quelques « Amis de la Terre » le bimestriel Le Sauvage à fin explicite de récupérer, broyer et évacuer les idées les plus fertiles de mai 68. De leur sanibroyeur sortent les conceptions cybernétiques de l’environnement : Sicco Mansholt, Alain Hervé, Edgar Morin, André Gorz, René Dumont, Brice Lalonde, transforment si bien le monde en données, la nature en « écosystème » et le vivant en machine, que les Amis de la Terre défendront les OGM et la reproduction artificielle d’humains.
Cette digestion chimique de l’écologie anti-industrielle n’a pas cessé depuis. Les lecteurs de Renart l’ont lue à propos de transition énergétique, d’intelligence artificielle, ou d’ingénierie reproductive. Ils sauront désormais de qui descendent les derniers gestionnaires du désastre, les planificateurs écologistes et autres « technocritiques ».
L’écologie se politise au milieu des années 1960 en débordant le mouvement conservationniste : les sociétés de protection, les parcs nationaux, les réserves naturelles – préservation de lambeaux de nature au milieu du désastre. Une foultitude d’ouvrages détaille ces origines. Prenons les deux plus emblématiques.
Jacques Ellul (1912-1994) analyse dès 1954 le fonctionnement du système technicien : la quête en toute chose du meilleur moyen possible. Il en démontre le caractère automate. Non seulement « Lorsqu’une forme technique nouvelle paraît, elle en permet et en conditionne plusieurs autres », mais la société recourt à la technique pour solutionner ses problèmes techniques. Cet emballement cède nécessairement la délibération démocratique aux calculs des experts, qui sont eux, par définition, indiscutables. Il en fait l’enjeu du siècle. Ellul incarne la veine « critique sociale » de l’écologie, d’essence libertaire.
La biologiste américaine Rachel Carson (1907-1964) représente la veine environnementale, plus anglo-saxonne. Elle publie en 1962 une étude accablante des méfaits de l’insecticide DDT et des polluants chimiques en général. Son Printemps silencieux met en pièce la toute-puissance de l’agrochimie d’après-guerre : « La croisade pour un univers chimiquement stérile et délivré d’insectes semble menée avec une véritable frénésie par beaucoup d’hommes de science. » Le succès est énorme (500 000 ventes en quelques semaines, une audition au Congrès). Il percute les mobilisations étudiantes contre l’usage de l’agent orange au Viêtnam et l’escalade atomique de la guerre froide. Un même ordre militaro-scientifico-industriel devient sujet de contestation dans les facs, les concerts de rock et les groupes pacifistes.
Permettez qu’on suggère une troisième influence de l’écologie, utile pour saisir les manœuvres des sanibroyeurs, car elle procède d’une certaine presse. Les comparaisons seront facilitées.
L’écologie satirique
L’année de publication d’Un Printemps silencieux (1962), un jeune diplômé des Arts décos se présente à Hara Kiri, le mensuel bête et méchant. Pierre Fournier (1937-1973) a déjà vendu quelques crobards à Minute (qui n’était pas encore d’extrême droite). Le rédac-chef Cavanna (1923-2014) finit par lui prendre quelques dessins et l’intègre à la rédaction en 1967. Fournier s’invente alors un personnage de grand reporter international, Jean Nayrien Nafoutre de Séquonlat, qui n’a sans doute jamais quitté l’Île-de-France. C’est l’année de la marée noire du Torrey Canyon en Bretagne.
Le reporter rapporte que les détergents balancés pour dissoudre le pétrole sont plus nocifs que le pétrole lui-même.
Hara Kiri lance un hebdo après mai 68. Il devient le porte-voix de la jeunesse effrontée qui récuse les ringards, les tenants de l’ordre policier dans les facs et les planificateurs de l’ennui quotidien. Avant même que Gébé n’y rapatrie de Politique Hebdo ses planches de L’An 01, Willem étrille les scientifiques nazis recyclés par l’industrie US (17 mars 1969), Fournier renvoie dos-à-dos Américains et Soviétiques dans leur course atomique mortifère (24 mars 1969), Cabu décrit le pathétique du « Dimanche à l’hyper-marché après la messe et le tiercé » (14 avril 1969). On se marre au bureau.
Quand les technos bruxellois préparent le marché commun agricole (on y reviendra), Cavanna leur catapulte une diatribe magistrale (21 avril 1969) : « Donc on va remembrer la France, le travail est même déjà bien avancé. Ça veut dire qu’il n’y aura plus ces petits bouts de champs ridicules, ces prés biscornus, ces haies hirsutes et ces bosquets mal famés qui déshonorent notre vieux pays sclérosé. Rien que la plaine infinie, euclidienne, pasteurisée, fonctionnelle, avec dessus vingt centimètres d’engrais-doping pour faire pousser les poireaux à la cravache. D’impeccables pistes de ciment qui fileront d’un horizon à l’autre et se croiseront à angle droit. Rien qui fasse désordre, rien qui fasse malpropre. Pas un arbre solitaire pour pisser contre. Fallait prendre vos précautions avant, ou alors pissez contre le vent, à vos risques et périls.
Il paraît qu’il fallait ça pour que la France ait une chance de tenir le coup en face des terribles producteurs musclés du Marché commun. Vous comprenez, le petit lopin sympa avec des myosotis au bord, c’est pas concurrentiel. La futaie ombreuse perturbe la trajectoire du tracteur et fait baisser la moyenne-chrono, ce qui est criminel d’un point de vue agronomique cartésienne et l’est encore bien davantage si l’on pense aux précieux instants productifs gaspillés à trousser Margot sur la mousse propice alors que les lits de Monsieur Lévitan – tout ronce de noyer verni polyester, dix-huit mensualités, rien à verser d’avance – sont là pour le confort du paysan, et au moment convenable : juste avant de s’endormir si l’on a eu le courage de fermer la télé avant le k.o. total.
Voilà. La campagne n’est pas un décor pour faire joli autour de vos piquenique.
La campagne est une usine à bouffe.
Ben, merde.
Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Quelque chose qui n’engage que moi : Le Marché commun, la France concurrentielle, JE M’EN FOUS. […] Des spécialistes très calés nous préparent un bonheur à base de prospérité gadgetoïde dans un univers sans bavures divisé en deux moitiés : d’un côté l’usine, de l’autre le parc de loisirs. Les spécialistes sont peut-être de bons gars, en tout cas ils ne sont que des spécialistes, c’est-à-dire des cons. […] »
On a rarement fait œuvre plus fertilisante.
Fournier, échaudé par Cavanna, publie son coming out écologiste une semaine plus
tard. On retrouve les thèmes classiques de l’écologie en dépit du terme : les nuisances environnementales, leurs responsables scientifiques, des questions autrement plus profondes que celles traditionnelles de la gauche et de l’extrême gauche. À quoi bon une vie plus égalitaire si elle est menacée d’extinction ou maintenue artificiellement dans l’univers concentrationnaire des technocrates ?
« J’emmerde la Déesse Raison, commence-t-il subtilement, ses dévots et ses bigots, et toutes les certitudes du scientisme rénové, façon vingtième siècle. […]
Un lecteur de Brive-la-Gaillarde m’écrit : »Comment pouvez-vous prétendre que la guerre et le racisme ne sont pas les grands problèmes de l’heure ? Êtes-vous fous ? » Je tiens mon prétexte et vais en profiter pour vous faire subir, ici même, l’exposé de mon petit point de vue pas personnel mais presque, juste pour une fois, pouce, je demande l’autorisation de ne pas faire le pitre. Alors voilà : Pendant qu’on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s’engendrent les unes les autres en répétant toujours la même chose, l’homme est en train, à force d’exploitation technologique incontrôlée, de rendre la terre inhabitable, non seulement pour lui mais pour toutes les formes de vie supérieure qui s’étaient jusqu’alors accommodées de sa présence. Le paradis concentrationnaire qui s’esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l’œuf. La seule vraie question qui se pose n’est pas de savoir si, oui ou non, son avortement provoquera notre mort.
Bien que quelques fadas n’aient pas attendu l’aurore du siècle pour la concevoir, cette idée est si neuve, et nous sommes depuis la maternelle si bien conditionnés dans l’autre sens, que personne encore ne l’a vraiment comprise.
Surtout pas les distingués académiciens qui tous les 28 jours, sur un ton désabusé mais élégant, nous emmènent sur la vieille balançoire intellectuelle du progrès, avec son avers et son revers. C’est trop monstrueux pour qu’on puisse y croire. Les gens sont comme ça, plus butés que les bœufs qui, conduits à l’abattoir, profitent de la première occase pour s’échapper. C’est pourquoi la catastrophe, beaucoup plus prochaine que vous n’imaginez, ne pourrait être évitée que par une réforme des habitudes mentales beaucoup plus radicale encore que celle jadis opérée par les rédacteurs de la Grande Encyclopédie. Ça représente du travail. »
Fournier reçoit une avalanche de courriers. Il y répond chaque semaine, défend son point de vue, affine, distingue, réfute, explique son départ à la campagne avec ses amis « naturistes » et « végétariens » : « Le boulot que je me suis trouvé, il y a six mois, et qui dévore chaque jour un peu plus mon emploi du temps, consiste à ranimer un vieux village, à empêcher qu’il ne soit, à la fois, déserté par les derniers habitants et recouvert par la chienlit vacancière. » Fournier est parmi les pionniers de cette génération partie expérimenter le « retour à la terre ». La suite d’Hara Kiri est à l’avenant. Cavanna entame des détournements publicitaires plus hilarants que les situs. Reiser traîne sa bêtise au Salon militaire du Bourget. Un dossier égratigne la vaccination obligatoire et la médecine-usine : pendant qu’une grosse bourgeoise de Cabu roucoule à son pharmacien « Qu’est-ce qu’on a reçu comme nouveautés ? », un médecin de Reiser témoigne de ses bonnes affaires : « Rien qu’avec la grippe, j’ai pu m’acheter un château dans le Périgord. »
Et puis… l’histoire mondiale de l’Humanité l’oublie systématiquement mais la Mission Apollo est contemporaine d’Hara Kiri. Or, le second n’est nullement étourdi par les aventures de la première, contrairement à la bonne société des gendepresses. Des trois « boy-scouts » stationnés là-haut dans leur « meccano », Cavanna s’en fout : leurs fusées serviront peut-être un jour à « transporter des petits pois frais cueillis ou des bonnes sœurs en pèlerinage », mais en attendant, leur science balistique costumée en « course à la Lune, c’est la trouvaille du siècle. Faire payer les bons couillons pour acheter les armes qui leur tomberont sur la gueule ». Quant à Fournier, il ridiculise ces philosophardes de cockpit sur le sens de la life et l’origine de l’universe : « Le pour-soi n’est autre que la pure néantisation de l’en-soi : il est comme un trou d’être au sein de l’être. En tant que néantisation, il est par l’en-soi ; en tant que négation interne, il se fait annoncer par l’en-soi ce qu’il n’est pas et, par conséquent, ce qu’il a à être….
– Oh merde, voilà l’ordinateur qui recommence à déconner tout seul ! », furibonde le pilote.
Il existe donc une branche satirique de l’écologie, radicale par les contraintes du dessin de presse, héritière des contes populaires (Renart le premier), qui se rit des puissants et des têtes de nœud. Elle ajouté aux évêques, aux gentilshommes et aux gens d’armes, les bureaucrates, les scientifiques et les intellos pompeux.
Entre l’armement atomique et le premier programme de centrales électriques, la question nucléaire façonne plus que n’importe quelle autre la pensée écologiste, notamment à Hara Kiri : l’ordre militaro-scientifique sur lequel repose l’industrie nucléaire tombe le masque démocratique des sociétés industrielles avancées.
La première marche contre le nucléaire civil est relayée par Fournier. 1 500 personnes défilent le 12 avril 1971 à Fessenheim en Alsace, devant le chantier de la première centrale. Trois mois plus tard, Fournier organise lui-même depuis les pages de Charlie Hebdo une manif devant la future centrale du Bugey dans l’Ain.
15 000 personnes, dix fois plus. Le rassemblement se termine au son des guitares psychédéliques en gigantesque camp nudiste – naturiste – peu au goût de Fournier.
Aucun journal n’en fait le compte-rendu, mais il s’est passé quelque chose au Bugey que la gauche ne peut ignorer longtemps. Des technocrates de haut rang vont lui offrir la possibilité de raccrocher la jeunesse. Ils forment une pièce maîtresse au milieu des épaves que Pièces et main d’œuvre commença de remonter en 2021 de La Marée verte.
La suite :
1972_-_les_sanibroyeurs_de_l_ecologie
