Les vieux réflexes ont la vie dure…
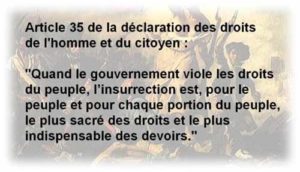
Comme en 2008, la crise est donc un moment de doute où les priorités politiques habituelles semblent comme suspendues. Exit l’égoïste, place à la solidarité… Secondaires les questions budgétaires, priorité à la santé… Pas cool la compétition économique internationale débridée, il nous faut d’urgence des millions de masques de protection que le monde entier s’arrache… Attention toutefois à ne pas prendre les vessies pour des lanternes pour gober tout cru, tel du velours, les discours politiciens du moment. Car si l’on peut saluer les mesures gouvernementales visant à enrayer au plus vite la pandémie du Covid-19, force est de constater que les mensonges, les non-dits et les faux-fuyants n’ont nullement déserté la scène…
Premièrement, les gouvernements taisent dans toutes les langues la responsabilité accablante des choix politiques passés dans l’aggravation de la crise du Covid-19. Pas une fois, on aura entendu un chef de gouvernement contester la privatisation passée de l’industrie du médicament fonctionnant à flux tendus, la foire aux délocalisations permise par les accords de libre-échange ou encore le manque criant d’investissements publics dans le secteur des soins de santé. Autant de renoncements politiques, vis-à-vis de l’intérêt général, qui ont pourtant un lien direct avec le manque de matériel médical visant tantôt à se protéger du virus (masques de protection), tantôt à détecter massivement sa présence dans la population. Il est vrai que Sophie Wilmès (Première ministre belge jugée exemplaire face à la crise par de nombreux médias) peut difficilement critiquer… les politiques d’austérité qu’elle a supervisée, de septembre 2015 à octobre 2019, alors qu’elle était ministre du Budget !
Cette amnésie initiale (surtout, pas un mot du passé…) conduit à d’autres mensonges plus détestables dans l’instant présent. Officiellement, on l’a dit, le discours politique a changé. Officiellement, dans la bouche des gouvernements, les mots travailleurs et travailleuses ne riment plus avec « grévistes ingrats, éternels insatisfait »s ou « quémandeurs sans fins de moyens qui manquent » ; le temps d’une crise, les voilà devenus héros de première ligne permettant le maintien d’activités essentielles tels que services médicaux, accès à la nourriture, respect des consignes de distanciation sociale ou encore encadrement de groupes humains enfermés pour diverses raisons (homes, prisons, services sociaux…). Toutefois, la réalité est plus triviale et moins reluisante : faute d’équipement pour les protéger efficacement, ces travailleurs et travailleuses sont aussi et souvent de la chair à canon. Qu’ils bossent en magasin, dans la logistique, le monde hospitalier, les homes ou différents services sociaux, ils sont tout bonnement envoyés au casse-pipes face au virus qu’ils doivent affronter sans test de dépistage (ni pour eux, leurs collègues ou les gens dont ils s’occupent) et sans maques de protection, alors même que les mesures de distanciation sociale sont parfois impossibles à maintenir dans certains contextes de travail. Ces travailleuses et travailleurs doivent donc s’en remettre à la chance, et à la débrouille en bricolant leur masque, pour ne pas être infectés et ne pas contaminer leur entourage !
La chose est d’autant plus grave (on parle tout de même d’un virus potentiellement mortel) que la définition des activités essentielles relève en partie d’un choix arbitraire effectué hors champ démocratique. Deux exemples concrets en témoignent : lors des premières mesures de confinement, les coiffeuses et coiffeurs ont dû se mobiliser pour obtenir l’arrêt légal de leur activité, initialement non concernée par la décision gouvernementale de fermer la plupart des commerces ; quant au puissant secteur de la chimie, il a obtenu le maintien d’activités aussi vitales… que la fabrication de jouets, de Tupperware ou de compléments alimentaires pour bodybuilders ! Bref, en ce mois d’avril 2020, les activités économiques se poursuivant sont loin d’être toutes essentielles… alors même qu’aucune garantie sérieuse de protection systématique n’est offerte à l’ensemble des salariés qui les exercent.
Cela nous renvoie à une vieille et sordide réalité : en temps de crise, les mesures d’urgence reflètent, reproduisent et intensifient souvent des inégalités déjà présentes dans les sociétés. C’est vrai pour l’isolement social (personnes âgées), pour la possibilité ou non de se protéger (tout le monde ne peut pas télétravailler), pour l’accès aux soins de santé (mieux vaut ne pas être pauvre aux États-Unis ou être un « Covid-19 » trop âgé dans n’importe quel pays…) ou encore pour l’obtention d’aides économiques d’urgence (sources potentielles d’abus et d’injustices qui mériteraient à elles seules un screening rapproché). Bien entendu, l’aggravation des injustices en temps de crise est aussi valable à l’échelle internationale, dans ces innombrables pays qui sont les perpétuels dindons de la farce cynico-tragique nommée mondialisation. A toute règle cependant, ses exceptions : s’il est une inégalité qui ne sort pas du tout renforcée de la crise sanitaire actuelle, c’est notre ego surdimensionné, notre prétention à tout dominer, notre soit disant supériorité sur la nature…
Ce que nous apprend le Coronavirus sur notre vraie nature
Car il faut bien le dire. Si un minuscule être invisible peut bousculer à ce point nos vies, et faire mettre un genou à terre aux plus puissantes organisations (privées comme publiques) de la planète, cela tient à un détail qu’on a tendance à occulter : nous faisons indissociablement partie de la nature… Certes, nous en sommes tous conscients d’une manière ou d’une autre. Mais lovés dans le confort moderne et biberonnés de technologies, nous vivons constamment sous perfusion marchande pour satisfaire l’essentiel de nos besoins. Aveuglés par ces intermédiaires qui nous sont familiers (magasins, e-commerce…), nous renvoyons dans les limbes de notre inconscience les longues chaînes de production qui s’étendent en amont, formant des réseaux en toile d’araignée qui relient les continents sous le contrôle hégémonique d’une poignée de firmes privées, devenues des empires marchands planétaires. Pourtant, c’est tout au bout de ces longues chaînes de production économique que se trouve la source ultime de toutes nos richesses matérielles : des produits miniers, des forêts millénaires, des pâturages pour bétail, des champs cultivés, des espèces végétales, animales, terrestres, marines, sous-marines…
Cette source ultime, nous l’avons complètement perdue de vue. Bien sûr nous savons qu’elle existe, nous savons même qu’elle fourmille de vie même s’il est plus commode de masquer ce fait perturbant sous des euphémismes (« matières premières, ressources naturelles ») ravalant tout à des objets inertes. Cette source ultime, qu’importe ce qui l’affecte, nous n’y voyons aucun rapport avec notre vie quotidienne. Une ruse de la raison… Un stratagème éventé pour bazarder à bon compte notre mauvaise conscience tant il est évident que ce rapport existe, qu’il est structurel et même extrêmement agressif… Pour que notre consumérisme effréné soit possible, il faut en effet passer par des stades où les empires marchands rognent, bouffent, traquent, détruisent et asservissent impitoyablement le monde naturel, faisant reculer espaces sauvages et disparaître par milliards les êtres vivants. Si accuser ces empires marchands de piller la Terre pour faire du profit est totalement légitime, éluder notre responsabilité personnelle et collective serait manquer de courage : esclaves de nos désirs matériels, nous sommes souvent complices volontaires de leurs méfaits, assoiffés de low-cost ou d’objets nouveaux et qu‘importe le coût social ou écologique à payer. Après tout, pensons-nous trop souvent, ce qui se passe à l’autre bout de la Terre n’a guère d’impacts négatifs sur notre quotidien…
Voilà pourquoi un Jair Bolsonaro (président d’extrême-droite du Brésil) peut aggraver la politique de ses prédécesseurs en rasant gratis la forêt amazonienne et la livrer en pâture aux producteurs de soja, désireux quant à eux d’augmenter leurs exportations de nourriture pour bétail, nous n’y trouvons rien à redire. Pas même quand l’Union européenne décide d’encourager ces pratiques mortifères en annonçant la conclusion d’un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur (dont fait partie le Brésil). Car après tout, les forêts tropicales, les ressources naturelles, ce qui se passe en Afrique, en Asie, en Amérique Latine, en Europe de l’Est ou ailleurs, la manière dont les empires marchands et le monde politique s’entendent pour puiser dans la source ultime des richesses matérielles, nous ne voyons toujours pas en quoi cela nous concerne. C’est si loin, si distant, si étranger à notre quotidien…
Mais cette distance est illusoire. Dans la nature, en effet, tout se tient : l’infiniment grand et l’infiniment petit, le visible et l’invisible, le proche et le lointain, hier et demain. Dans l’environnement, que cela nous plaise ou non, tout est interdépendant et tout bouge tout le temps… à l’image de ce super migrateur qu’est Covid-19 passant d’un humain à un autre pour arpenter la planète à sa guise. Dans la nature, ce qui s’est passé hier (17 novembre 2019) à des milliers de kilomètres de chez nous (Wuhan, Chine) peut impacter demain (mars, avril, mai, juin 2020…) ce qui se passera au plus près de nous. C’est-à-dire dans notre quotidien, sous notre toit, parmi nos proches et nos voisins, dans tous ces cœurs qui cessent de battre faute de pouvoir résister à la visite impromptue d’un virus qui ne demande l’avis de personne pour emménager où il veut.
S’il est une chose que peut nous apprendre Covid-19, s’il est une leçon à tirer de cette crise sanitaire, c’est bien celle-là : nous faisons partie de la nature et sommes intimement concernés par ce qui s’y passe, car d’innombrables liens unissent le proche et le lointain, entremêlant inextricablement hier et demain. C’est difficile à comprendre pour notre cerveau, plus doué pour les évidences immédiates (n’est vrai que ce qui se passe ici et maintenant, sous nos yeux), mais c’est pourtant une réalité que nous avons besoin d’intégrer dans nos façons de penser. Car nous vivons à l’heure d’une mondialisation, prétendument heureuse, dont les logiques de destruction sont bien moins impitoyables ici (dans les pays riches) qu’elles ne le sont ailleurs (dans des pays dits « pauvres »).
Or, même en limitant le débat aux rapports humains, qu’on cherche par exemple à endiguer l’exil de millions de migrants ou à apaiser les rancœurs multiples envenimant le cœur des postulants au terrorisme, se soucier de ce qui se passe ailleurs est un devoir civique. Un devoir de solidarité, au même titre qu’éviter de contaminer les autres quand une pandémie mortelle rôde alentours. Cependant, nous ne pouvons plus limiter les débats à la seule sphère humaine. Cette manière de penser, révolue, est dangereuse à l’heure où la mondialisation interfère dans des processus naturels majeurs, et perturbe gravement des liens d’interdépendance d’une incroyable élasticité en termes de temps et de distance.
Il est temps de comprendre que des activités économiques remontant bien avant notre naissance (par exemple, du temps de nos grands-parents) peuvent bouleverser de fond en comble le quotidien futur de proches qui ne sont pas encore nés aujourd’hui (par exemple, celle de nos petits-enfants). De la pollution nucléaire au réchauffement climatique généré par les gaz à effets de serre, les exemples sont multiples…
Et demain ?
Qu’on parle d’extermination massive d’êtres vivants, de biodiversité en chute libre, d’éradication d’écosystèmes marins ou forestiers, de pollutions chimiques ou de réchauffement climatique (pour ne citer que quelques-uns des problèmes environnementaux contemporains), une chose devrait nous frapper l’esprit : les mécanismes à l’œuvre sont grosso modo les mêmes que ceux qui régissent la crise du Covid-19 !
Là aussi, des scientifiques spécialistes du vivant disposent d’une connaissance précieuse pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces crises majeures… Là aussi, les scientifiques spécialistes du vivant mettent en garde : nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était et feindre d’ignorer le problème en espérant passer au travers. À ne rien changer à nos habitudes collectives, à poursuivre la route du business as usual, nous courons tout droit vers des catastrophes qui donneront à la crise sanitaire actuelle (celle du Covid-19) les traits d’une aimable plaisanterie. Car l’horreur qui s’annonce est celle d’une cascade cumulative d’évènements catastrophiques (où les virus inconnus ne seraient qu’un de nos nombreux ennuis) s’amplifiant les uns les autres ! Là encore, les scientifiques ont le sens du timing : à l’heure où nous parlons, sur des enjeux planétaires comme le réchauffement climatique, nous avons déjà dépassé le stade de l’Espagne ou de l’Espagne s’y prenant trop tard pour contrer le Coronavirus. Autrement dit : même avec les meilleures mesures du monde prises aujourd’hui, les dés de l’interdépendance entre hier et demain sont déjà lancés et vont provoquer, dans les décennies et siècles à venir, des catastrophes majeures (montée des océans, évènements météos extrêmes, perte de fertilité agricole…) dont une partie considérable de l’humanité va souffrir.
Malgré tout, là aussi, là encore, nous avons le choix. Le choix, par exemple, de vouloir « être libre de continuer à faire n’importe quoi ». Sortant de la crise du Coronavirus, nous crions hip hip hourrah à la découverte d’un vaccin et de médicaments efficaces, et on reprend tout comme avant. Pour un tour de manège, on se relaisse emporter par l’égoïsme capitaliste et l’utopie politique qui a dominé les dernières décennies : laissons faire les empires marchands, poursuivons la foire aux délocalisations, faisons payer la crise sanitaire aux finances publiques, laissons les actionnaires se gaver de profits, votons en faveur des fachos si on est déçu par le système, applaudissons aux ramifications infinie des réseaux d’espionnage numériques, et continuons joyeusement à détruire la planète ! En cas de doute ou de panique, suçons notre pouce et écoutons papa-patronat et maman-économie nous fredonner que la croissance infinie offrira, un jour lointain, des miettes de richesse aux pauvres du monde entier. Ce choix-là est le choix du pire : celui qui consiste à faire la fête, à inviter des amis, à nocer avec des inconnus, à rouler des pelles au hasard, à ne penser qu’à soi et qu’à court-terme en pleine pandémie de Coronavirus…
Alors que le confinement nous ramène aujourd’hui à l’essentiel (nous sommes tous mortels, le filament qui nous tient en vie est fragile, et une existence réussie consiste à être heureux avec ses proches et ses amis), nous pouvons aussi renoncer aux fables absurdes de l’économie. La croissance infinie des productions matérielles est un mythe, grotesque, aussi peu crédible pour notre futur que chercher l’origine de l’humanité chez Adam et Ève. Renonçant à cette folie, on doit alors prendre acte que la solidarité n’est pas un luxe qu’on ne peut plus se payer, mais bien au contraire un impératif prioritaire : il faut limiter les écarts de richesse, et par conséquent raboter sérieusement les possessions inouïes des plus riches parmi les nantis, car aucune société démocratique ne peut avancer en abandonnant une multitude de ses semblables au bord du chemin. Par semblables, nous devons évidemment inclure les humains d’ici, mais aussi les humains d’ailleurs – autrement dit, revoir de fond en comble les termes iniques et les rapports faussés du commerce international avec des pays devenus pauvres à force d’avoir été saignés à blanc par d’avides multinationales, d’opulents états et des siècles de colonialisme occidental…
Si d’aventure vous trouvez que c’est beaucoup exiger d’une démocratie, sachez que ce n’est pas encore assez. Car parmi nos semblables à ne pas abandonner en bord du chemin, il faut aussi inclure ces milliards de vies – animales, végétales, terrestres, marines… – qui nous rendent au quotidien une multitude de services totalement gratuits (comme fabriquer de l’oxygène, transformer des toxines en nutriments, nous fournir de l’eau douce, réguler le climat, etc.). Des services innombrables et tellement gratuits qu’ils en sont, à nos yeux d’experts-comptables, tout aussi invisibles que le Coronavirus… Mais ces services existent bel et bien, et si nous voulons qu’ils persistent pour les générations futures, c’est aujourd’hui et maintenant que nous devons accorder une place plus grande aux vies sauvages, aussi bien dans nos consciences que sur la planète.
Bien sûr, rien de tout cela n’est simple. Cela implique de reconnaître qu’on s’est trompé de chemin. Cela nécessite de changer de fond en comble certaines de nos habitudes. Sur le plan individuel, cela implique de renoncer à des réflexes compulsifs et des frénésies consuméristes, procurant des plaisirs si fugaces qu’on doit les renouveler constamment… Sur le plan collectif, cela requiert de prononcer le divorce – qu’on peut entamer par un confinement dans des chambres séparées – entre l’état et les empires marchands. Car même vêtues du droit de vote et d’expression, nos démocraties contemporaines sont confisquées par des pouvoirs privés qui feraient pâlir d’envie – en termes d’influence, mais surtout de nuisances – les plus fous des Inquisiteurs de l’église catholique à l’époque médiévale. De nos jours, les empires marchands dictent de nombreuses lois à l’Europe, imposent l’austérité aux pouvoirs publics, équipent nos maisons et lieux de vie de dispositifs de surveillance électronique, nous charment à coups de publicités mais polluent notre environnement, souillent nos corps de toxines, hypothèquent l’avenir de générations qui ne sont pas encore nées, ravalent l’intérêt général au rang de caprice désuet, et ont le toupet et la morgue d’ajouter qu’on devrait compter sur eux pour résoudre la multitude de problèmes qu’ils génèrent et ne cessent d’amplifier !
La fin de cette époque doit sonner. Le Dieu marchand tout puissant doit descendre de son trône, car nous avons d’autres priorités à assigner aux états que celle d’une course infinie aux profits permanents. Osons le mot : une révolution culturelle nous attend. L’étreindre ou lui tourner le dos dépend de nos choix. Comme ce fut mon cas avec le coronavirus, on peut avoir le déclic collectif ou pas. Mais l’horloge tourne, ce que nous faisons ici et aujourd’hui aura des conséquences demain et ailleurs. Pour le meilleur comme le pire, nous disposons du libre-arbitre, du droit de vote, du droit de grève, du droit d’insurrection, du droit de manifester, du droit de boycotter, du droit de penser aux autres et du droit de penser différemment des autres. Nous disposons aussi du droit de faire des liens entre ici et ailleurs, entre aujourd’hui et demain, du droit d’être un rouage passif dans la machine économique ou un grain de sable branché sur courant alternatif. En un mot comme en cent, nous disposons du droit de rêve collectif. C’est gratuit. C’est puissant. C’est infini. Il faut juste avoir le courage et l’envie de s’en servir… à plusieurs de préférence… raison pour laquelle il est crucial de serrer la main et d’embrasser les rêveurs et rêveuses qu’on croise en chemin !
Bruno Poncelet ; pour.press
