Elle s’accorde mal avec la science
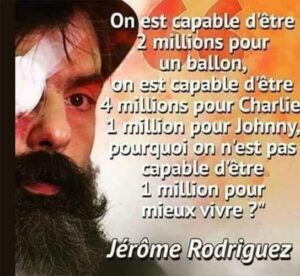
Une opinion publique prise à témoin, des citoyens qui s’affrontent par études scientifiques interposées, des responsables politiques, sommés de prendre des décisions dans l’urgence, qui en appellent à l’avis des experts, etc. La controverse scientifique concernant la chloroquine et la polémique autour du professeur Didier Raoult se sont propagées comme une traînée de poudre dans l’espace public. Les citoyens s’intéresseraient-ils enfin, à la faveur de la crise sanitaire actuelle, à la recherche scientifique ? Et y aura-t-il un avant et un après-Covid-19 pour les chercheurs ? Des questions à Jacques Testart, biologiste et « critique de science ».
Sciences Critiques – Que vous inspirent le travail et la stratégie de communication du professeur Didier Raoult au sujet de la chloroquine ? Incarne-t-il la « bonne science biomédicale » – de terrain, voire citoyenne, en répondant à l’urgence sanitaire – contre la « mauvaise science biomédicale » – bureaucratique, technocratique et inféodée à l’industrie pharmaceutique ?
Jacques Testart – Je crois, d’abord, qu’il ne faut pas identifier la pratique médicale à une activité scientifique, et les thérapeutes à des chercheurs scientifiques. Pour la plupart, les médecins n’ont ni la formation ni la pratique qui sont exigées des chercheurs, lesquels, pour leur part, n’ont pas vocation à guérir. En ce sens, nous avons assisté à l’affrontement entre un praticien soucieux de tout faire pour guérir ses malades et des responsables médicaux soucieux de singer, comme pour combler leur manque, ce que serait une démarche scientifique.
Les affirmations des officiels, des médecins et des scientifiques démontrent, par leur cacophonie, que la science n’est pas de la partie, car c’est l’ignorance savante qui sévit, souvent avec arrogance.
La personnalité de Didier Raoult et son passif – anti-darwinien, climatosceptique – ont donné des points à « la science » qui le critique, sans que celle-ci se risque à trop pavoiser de crainte que l’avenir lui donne en partie raison… Et le patron marseillais nargue les patrons parisiens sans expliquer comment ceux-là l’ont fait patron s’il n’a pas un jour opportunément courbé l’échine devant la hiérarchie. Mais ce show très médiatisé atteint aussi les sphères militantes, avec la grande question qui sépare des frères d’armes en politique plutôt qu’en santé publique : faut-il donner la chloroquine en lot de consolation du progrès qui foire ou l’interdire au nom de la science qui progresse ? On s’engueule, certains démissionnent. Pas sûr que le recul du virus permettra une analyse plus sereine de ce passif, car la gestion à chaud de l’urgence s’accordera toujours mal avec la froide sérénité de la science.
Notre prix Nobel Luc Montagnier – un nouveau Raoult ? – propose, à condition qu’on lui donne « d’énormes moyens », un remède révolutionnaire en émettant des ondes qui interféreraient avec « les ondes de l’ARN viral ». Et il proclame que « la vérité scientifique finit toujours par émerger ». Pourtant, ce biologiste n’a jamais pratiqué la médecine. Au-delà des énormités proclamées par quelques-uns, il reste que les affirmations des officiels, des médecins et des scientifiques démontrent, par leur cacophonie, que la science n’est pas de la partie, car c’est l’ignorance savante qui sévit, souvent avec arrogance.
Que révèle, selon vous, la pandémie de Covid-19 concernant la recherche scientifique en général et la recherche biomédicale en particulier, à l’échelle européenne comme à l’échelle française ? Y aura-t-il un avant et un après-Covid-19 pour la communauté scientifique ?
On évoque beaucoup « le jour d’après » pour un renouveau sociopolitique, mais les dimensions recherche et santé se cantonnent à la réintroduction en France des moyens thérapeutiques nécessaires – médicaments, protections, équipements spécifiques – et un peu, puisque nos décideurs ont eu la frousse, à l’augmentation des moyens alloués à la connaissance des virus et à la gestion des pandémies. Les procès promis montreront les carences au plus haut niveau et il faudra bien boucher les trous trop voyants. Ainsi, grâce au récit du chercheur Bruno Canard, expliquant comment ses moyens de recherche sur les coronavirus ont été supprimés, et grâce aussi à notre incapacité théorique pour affronter cette maladie, la nécessité de la recherche pour la connaissance devrait apparaître dans la masse d’argent dédiée aux vaccins et médicaments.
Faudra-t-il d’autres crises sanitaires en d’autres domaines pour que les financiers prennent enfin la mesure des dégâts occasionnés par la technoscience ?
Pour la communauté scientifique spécialisée, la situation sera nettement améliorée, en France, en Europe et partout, puisque les dégâts économiques et sociaux sont énormes et mondiaux. Mais, faudra-t-il d’autres crises sanitaires en d’autres domaines pour que les financiers prennent enfin la mesure des dégâts occasionnés par la technoscience – en particulier les perturbateurs endocriniens ? La « chance » scientifique qu’offre cette pandémie est son irruption brutale, généralisée et bien visible, qui en ont fait un spectacle universel, alors que bien des atteintes à la santé, telles que les maladies chroniques comme l’asthme ou l’obésité, s’avèrent beaucoup plus graves, mais plus insidieusement. Pourtant, c’est la fréquence croissante de ces maladies chroniques qui transforme un virus plutôt banal en un redoutable tueur.
On ne peut espérer se protéger des maladies, virales ou pas, qu’en rompant avec les pratiques qui en sont les cause – déforestation, appauvrissement et déséquilibres de la biodiversité, exploitation forcenée des ressources, pollutions de l’environnement, changements climatiques, etc. [1] Ce programme ne dépend pas des laboratoires de recherche mais de la décision politique. Sans mesures drastiques qui exigent la décroissance des consommations et des pollutions, le virus reviendra avec un déguisement nouveau nécessitant à chaque fois de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins, c’est-à-dire que les sociétés seront toujours démunies devant le retour du bâton qui leur procurait une jouissance stupide, quels que soient les moyens donnés à la recherche.
Que pourrait être une recherche scientifique ayant tiré toutes les leçons de la pandémie de coronavirus ? Plus particulièrement, à quoi ressembleraient les sciences dans une société post-croissance ?
Historiquement, les chercheurs ont été des travailleurs intellectuels jouissant d’une liberté unique parmi les salariés de l’Etat. C’était l’époque où la science jouissait d’une image très positive malgré quelques drames – comme l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima [2] – qu’on attribuait à son usage indélicat. Mais les chercheurs, encore peu nombreux, jouissaient d’une grande autonomie. Depuis quelques décennies, l’économie a été mise aux commandes des laboratoires grâce à des partenariats industriels ou des fichages thématiques, rompant avec l’image d’une science pure dédiée à la connaissance [3]. Simultanément, la puissance de recherche augmentait avec sa nouvelle idéologie – compétition, brevets, start-ups, etc. – tandis que des effets défavorables de ce qu’on a appelé la « technoscience » [4] se multipliaient. Ainsi, il est devenu évident que la recherche n’est plus une activité essentiellement « poétique », c’est-à-dire la découverte de l’inconnu, mais la principale source des modes de vie à venir – innovations par principe, « maîtrise » du vivant improbable mais toujours expérimentée [5], obsession de la vitesse, numérisation de la société [6], etc. Et donc qu’elle ne doit plus échapper au jugement des citoyens.
La question actuelle n’est pas celle toujours posée par les syndicats de chercheurs, même s’il faut exiger plus de moyens pour la recherche. Elle est de savoir à quoi, à qui, sert la recherche.
La question actuelle n’est pas celle toujours posée par les syndicats de chercheurs, même s’il faut exiger plus de moyens pour la recherche. Elle est de savoir à quoi, à qui, sert la recherche [7]. Les chercheurs ne peuvent plus prétendre décider seuls de ce qui serait bon pour la société qui les rémunère. A l’évidence, les priorités décidées en haut laissent les citoyens de côté : qui, parmi nous ou nos enfants, ira sur la lune ? Qui demande des plantes génétiquement modifiées ? etc. Il s’agirait donc de définir ce qui est bon pour la majorité des humains qui peuplent la terre ; mission impossible si ce n’est démagogique, sauf en la proposant aux citoyens eux-mêmes. En ce sens, les questions proposées par Bruno Latour [8] cernent utilement la problématique du besoin de science, ou surtout de technologie, de la population à ce tournant où on ne peut plus continuer comme avant. Mais ces questions ne peuvent obtenir de réponses politiquement acceptables que si elles ont été fondées sur la raison et l’information. C’est pourquoi, l’association Sciences citoyennes avance, depuis longtemps, le recours à des conventions de citoyens [9]. Elle vient de proposer cette procédure pour définir la future Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) [10]. Des conventions de citoyens peuvent en effet indiquer, en connaissance de cause, la répartition souhaitable des budgets entre grandes thématiques – santé, alimentation, vie quotidienne, énergies, environnement, etc. –, au risque prévisible que la « décroiscience » bouleverse les priorités actuelles.
Pour le reste, faisons confiance aux nombreux Bruno Canard de la recherche publique pour creuser les domaines que leur savoir leur fait croire utiles pour demain. Aujourd’hui, le métier de chercheur ne peut trouver sens que dans la co-construction des savoirs avec et pour les citoyens. Nous ne craignons pas que la recherche dite « fondamentale », celle qui a pour vocation la connaissance plutôt que l’innovation, se trouverait affectée par la démocratisation des choix – des sondages le prouvent. Bien au contraire, il faut attribuer à la recherche de connaissances des budgets conséquents et récurrents, car c’est celle qui exige le plus d’investissement et qui soutient la possibilité des recherches finalisées que souhaiterait la population, lesquelles contribueront à une décroissance émancipatrice plutôt que douloureuse.
References
[1] NDLR : Lire notre « Grand Entretien » avec Joël Spiroux de Vendômois : « Le XXIème siècle doit devenir le siècle de l’hygiène chimique », 10 juin 2016.
[2] NDLR : Lire la tribune libre d’Olivier Rey, Nuclear Manœuvres in the Dark, 17 mars 2016.
[3] NDLR : Lire le texte du Groupe Oblomoff, Pourquoi il ne faut pas sauver la recherche scientifique, 4 mars 2015.
[4] NDLR : Lire le texte de Geneviève Azam, Dominique Bourg et Jacques Testart, Subordonner les technosciences à l’éthique, 15 février 2017.
[5] NDLR : Lire notre « Trois questions à… » avec Geneviève Azam : « Abandonner le délire prométhéen d’une maîtrise infinie du monde », 15 septembre 2018.
[6] NDLR : Lire notre article : La technologisation de la vie : du mythe à la réalité, 1er mars 2018.
[7] Voir sur le site Internet de l’association Sciences Citoyennes : Organiser la recherche, oui mais pour quels savoirs ? Pour une recherche avec et pour les citoyens (Mediapart, 12 février 2020).
[8] Voir sur le site Internet d’AOC : « Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise », 30 mars 2020.
[9] NDLR : Lire notre « Grand Entretien » avec Jacques Testart : « Il faut prendre le mal à la racine », 30 mai 2017.
[10] Voir sur le site Internet de l’association Sciences Citoyennes : Loi Recherche : quelle organisation de la recherche pour quels savoirs ?, 4 février 2020./
https://sciences-critiques.fr/
